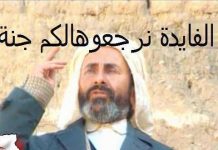PAR AW · PUBLIÉ JANVIER 11, 2022 · MIS À JOUR JANVIER 11, 2022
Fatima-Zohra, 64 ans, Belcourt, Algeria-Watch, 11 janvier 2022

Trente ans après le 11 janvier 1992, ce qui me revient de la période autour du coup d’État est une impression générale de tristesse devant un immense gâchis. Au cours de ces journées balayées par un mauvais vent, j’étais aussi préoccupée par des soucis personnels. Ma grossesse arrivant à terme, j’essayais autant que possible de ne pas me laisser submerger par des pensées négatives. Difficile tant les événements des derniers mois ressemblaient à la lente dissipation d’un rêve de liberté.
Mon sentiment oscillait entre déception et inquiétude. Je percevais comme beaucoup la fin de l’illusion démocratique. Après les centaines de morts du 5 octobre 1988, la folle espérance de l’ouverture politique se figeait dès le mois de juin 1991 pour s’éteindre dans cette froide et morne journée de janvier. Un dénouement logique au vu de l’enchaînement des événements…
En effet, l’été 1991 a été celui de l’enterrement du programme conçu par les réformateurs, des arrestations spectaculaires de dirigeants du FIS et de l’incohérence politique dans une atmosphère chargée de tension et de malaise. L’Algérie donnait l’impression d’un navire sans gouvernail. Dans mon milieu professionnel, les informations sur les perspectives électorales de décembre 1991, qui laissaient espérer un net reflux du parti islamiste, étaient prises pour argent comptant.
La victoire du FIS au premier tour des élections législatives en décembre 1991 a donc davantage choqué par son ampleur. Face à ce raz-de-marée, nos amis partageaient le pessimisme de mon entourage immédiat. Nous savions que ce résultat électoral ne serait pas accepté par les généraux, qui, plus que jamais, concentraient la réalité du pouvoir.
En novembre 1991, l’étrange assaut contre une caserne à Guemmar au sud-ouest du pays, par un groupe d’individus présentés comme membres ou proches du FIS était lourd de sens et préfigurait un très mauvais scénario. Ces généraux ne quitteraient pas la table : il y avait beaucoup d’intérêts en jeu et l’on sentait que tout allait se précipiter.
Le 2 janvier 1992, l’immense manifestation pour le maintien du second tour des législatives à l’initiative d’Hocine Aït-Ahmed a été un ultime espoir et pour très longtemps, jusqu’aux manifestations du Hirak en février 2019, le chant du cygne des mobilisations démocratiques. Pour mon entourage proche, l’intervention de l’armée ne faisait pas de doute. L’ambiance était extrêmement tendue, les islamistes ne fêtaient pas vraiment leur succès. Au contraire, leurs dirigeants, Abdelkader Hachani notamment, semblaient soucieux de relativiser un résultat trop massivement favorable.
Ces premières journées de janvier passèrent très rapidement, dans un climat empoisonné par les déclarations alarmistes de certains personnages publics qui, bien qu’ignorés complètement par les électeurs, occupaient le théâtre médiatique. Certains prédisaient un nouvel Afghanistan, d’autres évoquaient l’« urne fatale » et de noires perspectives dans l’hypothèse d’une prise de pouvoir par le FIS. Alger retenait son souffle. La « démission » télévisée du président mettait un point final aux supputations qui fusaient au cours des discussions interminables dans mon environnement professionnel. Le spectacle offert par la télévision algérienne, décalé au point d’en être embarrassant, sonnait faux. Personne n’était dupe de la mise en scène interprétée par de mauvais acteurs, l’expression hébétée du président du Conseil constitutionnel recevant la lettre de démission de Chadli Bendjedid est gravée dans ma mémoire. Il n’y a plus d’élections et plus d’institutions fonctionnelles, l’État est un bien vacant bientôt accaparé par des occupants sans titre… Trente ans après, c’est toujours le cas.
La crainte de lendemains troublés était le sentiment dominant, une vraie inquiétude partagée par tous était perceptible, mais personne dans mon entourage n’envisageait la terrifiante et très longue descente aux enfers vécue par l’Algérie. Même si les généraux qui avaient organisé le coup d’État étaient connus : certains étaient responsables de la sanglante répression des jeunes manifestants d’octobre 1988 et d’autres étaient les chefs des filières de détournement.
Mohamed Boudiaf, comme sorti d’un chapeau de prestidigitateur, arrive à Alger. Comment un homme d’une telle envergure historique, en exil depuis des décennies, qui avait la réputation d’être intègre et désintéressé, pouvait-il s’associer à un coup d’État ? De manière encore plus surprenante, Boudiaf décidait de couvrir les premières exactions des putschistes : des jeunes de mon quartier avaient été enlevés par la police ou l’armée (on ne savait pas vraiment) et expédiés dans des camps au Sahara. Plusieurs dizaines de milliers de citoyens à travers tout le pays avaient été raflés et envoyés, illégalement, dans ces lointains centres de détention. La propagande du régime, qui le présentait comme le barrage républicain à l’obscurantisme islamiste, justifiait donc les pires moyens…
Au début de l’été, Mohamed Boudiaf est assassiné en direct. La nouvelle suscite un mouvement de panique dans le personnel de l’établissement ou j’exerce. La fusillade télévisée ressemble à une menace et à un avertissement adressé à tous. La tristesse et le désespoir d’abord et, de plus en plus, la peur s’installent dans la société qui découvre un terrorisme aux ressorts incompréhensibles et une répression féroce, incontrôlée, illimitée. La violence et la peur, omniprésentes, s’insinuait dans nos existences suspendues.
Au cours de cette année 1992, l’air d’Alger devenait progressivement irrespirable. À la suite d’une succession de menaces et d’événements brutaux, dont certains m’ont directement et personnellement affectés, j’ai été obligée de prendre le chemin de l’exil avec ma famille, dès la fin 1992. Comme beaucoup, le coup d’État a brutalement changé le cours de mon existence. Et comme tous les exilés, j’observe avec peine et amertume la dérive du pays.
Les généraux ont déclenché une marée de sang qui a submergé l’Algérie pendant dix années. Quand cette effroyable marée se retirera enfin, elle cédera la place à une décennie aberrante, entre gaspillage et pillage. Épilogue d’une mauvaise pièce écrite par un dramaturge pervers, le fol espoir d’une Algérie libre du vivre ensemble né en octobre 1988 s’est tragiquement évaporé dans un crépuscule sanglant d’occasions ratées. Hier le contrat de Rome et aujourd’hui, de manière éclatante, le Hirak, montrent les valeurs portées par la société. Mais le régime putschiste, enkysté, s’est replié dans son autoritarisme et sa brutalité. La répression générale et le mensonge restent ses méthodes de prédilection, la dictature enfonce l’Algérie dans une crise sans issue.
Ce 11 janvier 1992 a ouvert un des chapitres les plus tragiques de toute l’histoire de l’Algérie.